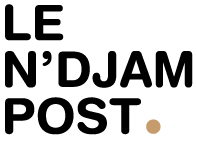Le quotidien de nos concitoyens est de plus en plus façonné non par l’autorité légitime de la loi, mais par l’arbitraire d’un État qui s’impose par la force. La violence, longtemps limitée aux faits de la société, s’est hissée au sommet des institutions pour devenir un mode de gouvernance. L’État n’agit plus pour protéger ou réguler, mais pour contraindre, punir et exclure sans ménagement.
Les décisions prises sont brutales, souvent dénuées de fondement légal clair et dépourvues de tout mécanisme d’accompagnement. Les interdictions pleuvent comme des couperets, sans pédagogie ni concertation, et leur efficacité reste marginale, la durée effective de leur application étant toujours courte dans les faits. Pire encore, la justice elle-même, ultime rempart contre l’injustice, est piétinée. Les procédures sont ignorées, les vices de forme se banalisent, et ceux qui devraient répondre de leurs actes – corrompus, détourneurs de fonds publics, prédateurs économiques – s’en sortent en profitant de ces failles procédurales, conséquence directe d’un usage dévoyé de la force. On s’empare de n’importe qui, comme on capture un vulgaire mouton, on le met dans les geôles, on ignore les délais de garde à vue et ensuite, on commence à réfléchir à comment l’inculper…
Quant aux opposants politiques, ils sont systématiquement privés de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable. La même brutalité aveugle s’abat sur eux, sans nuances, sans respect pour les droits fondamentaux, sans égard pour l’opinion publique, qu’elle soit nationale ou internationale. La loi, au lieu d’être un rempart, devient une arme de répression. Yaya Dillo et ses compagnons ont été massacrés ; le siège de son parti a été littéralement rasé. Robert Gam, son secrétaire général, croupit encore en détention arbitraire, suspendu au bon vouloir de ceux qui se comportent en seigneurs de guerre : décideront-ils de le libérer ou de le livrer enfin à une justice digne de ce nom ? Idriss Youssouf Boy, lui aussi, reste incarcéré. Son sort sera-t-il tranché à huis clos dans un conciliabule familial, pour aboutir à un nouveau pardon arrangé ? Ou bien prétendra-t-on cette fois rendre la justice ? Mais, dans ce cas, selon quelle procédure, avec quelles garanties ? Voudrait-on que la justice soit efficace ou bien voudrait-on faire de la justice un instrument d’asservissement, d’humiliation ?
Qu’un ministre de la Sécurité publique, issu des forces de l’ordre, multiplie les arrêtés d’interdiction – par exemple sur les vitres fumées – sans jamais s’attaquer aux autorisations illégales déjà octroyées, passe encore. Mais qu’un maire, jeune, intellectuel et fraîchement élu de surcroît, se distingue par des mesures brutales, comme l’interdiction subite faite aux sociétés de transport inter-urbain de charger sur les voies publiques ou aux commerçants de vendre aux abords des routes, interroge sur la légitimité de l’usage du pouvoir. Une société de transport a besoin d’espace, de temps pour s’adapter à la réglementation. Elle a surtout droit, en contrepartie des impôts qu’elle paie, à un accompagnement de l’État, à des orientations politiques claires pour le secteur. Les commerçants ont besoin d’espaces réservés et aménagés pour leurs activités ; interdire l’usage des abords des routes n’est ni une réponse à un réel problème, ni une solution durable à l’encombrement des voies publiques… Il y a quelques jours, nous avions sollicité notre participation aux consultations citoyennes organisées par les nouvelles autorités municipales élues pour partager notre vision « N’Djamena nouveau, ville de paix et de lumières ». Sans réponse !!! Et pourtant, notre contribution aurait pu offrir des pistes durables de développement à ce secteur vital qu’est le transport interurbain….
Comme le rappelait Max Weber, l’État moderne ne peut prétendre à la légitimité que s’il « revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime », c’est-à-dire une force encadrée par la loi, au service du bien commun – non des intérêts partisans.
À toutes les autorités élues, et à notre jeune frère Senoussi H. Abdoulaye : il est temps d’inverser cette dynamique destructrice, de changer de culture de gouvernance. Il est temps de redonner force à la loi, et non à la loi de la force. Cela signifie en finir avec la gouvernance par décret et intimidation. Toute mesure prise – au niveau central comme local – doit être légale, proportionnée, expliquée et accompagnée. Cela suppose de faire des institutions les lieux du débat démocratique, y compris avec les opposants, et non des scènes de confrontation brutale. Nos propositions dans la lettre ouverte du 19 juillet 2024 à la Direction générale de la police nationale pour des contrôles plus intelligents des véhicules roulants – notamment sur les vitres fumées – sont restées lettre morte… Parce que la violence, c’est aussi ce rejet systématique de toute idée venant d’un opposant, sauf pour l’affaiblir et le désarmer. Oui, il est plus que temps de faire place à la gouvernance inclusive, à l’écoute du citoyen, quelle que soit sa casquette politique, sa religion ou sa région.
Il est temps de restaurer l’État de droit. Cela commence par une justice indépendante et des procédures scrupuleusement respectées. Cela passe par des forces de sécurité formées aux droits humains, à la gestion pacifique des conflits, contrôlées par des mécanismes civils et transparents. Mais comment y parvenir, quand ces forces ne protègent ni le territoire, ni les citoyens et ses biens, mais défendent un pouvoir clanique ?
Comme le disait Pierre Bourdieu, « la force de la loi est d’autant plus grande qu’elle est perçue comme légitime ». Or, une loi qui fait peur, une loi qui protège les puissants et humilie les faibles, perd toute légitimité. Et quand la brutalité sert à couvrir l’impunité – y compris celle qui viole la Constitution, comme son article 77 – que reste-t-il à espérer ?
Le Tchad a besoin d’un État fort, oui, mais d’une force au service du droit – et non d’un droit écrasé par la force. Le respect des règles, la transparence et la justice sont les seuls piliers durables d’une autorité légitime. Sans cela, nous bâtirons sur la peur et la colère – des sables mouvants pour une nation qui veut la paix et le progrès.
Quand la loi devient injuste, il revient au peuple d’assumer légitimement sa responsabilité : désobéir. S’ils persistent à gouverner en « vainqueurs assiégés », usant sans retenue de la force publique, ils s’égareront tôt ou tard dans les contradictions et les dérives de la mauvaise gouvernance. Ce n’est qu’une question de temps. Ce bateau Tchad dans lequel nous sommes tous embarqués, nous n’allons pas l’abandonner indéfiniment entre les mains d’un équipage indélicat et aveuglé par le pouvoir.
À nous, désormais, de préparer l’avenir – un avenir juste, apaisé, radieux, pour notre peuple.
Ayé, nagdoro!
Djoret Biaka Tedang