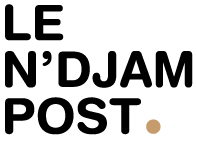Au Tchad, parmi nos traits les plus singuliers, il y a la culture du « carrefour ». Ce terme, dans son sens tchadien, désigne ces endroits où les jeunes N’Djaménois et même les plus vieux parfois se réunissent pour tuer le temps. Souvent sur des chaises devant les devantures des maisons ou assis sur une natte à siroter du thé.
Les « carrefours », ce sont les terrasses de café à la tchadienne, là où on se retrouve entre amis à refaire le monde, à parler de des rêves et des aspirations, à discuter de politique et de faits divers. C’est là où l’on se réfugie pour fuir les turpitudes de la vie, pour oublier les dures réalités de ce pays. C’est là où l’on se moque, où l’on rigole, là où l’on se dispute et là où l’on se réconcilie.
C’est là où l’on parle aussi des gens, des autres, de « filane wa filane ». On adoube certains pendant que d’autres sont cloués au pilori. On grossit les traits, on dramatise, et parfois même, on invente.
Mais tout le monde laisse faire, parce qu’on sait faire la part des choses, et aussi parce qu’il y aura toujours quelqu’un pour dire : « yakhai chokholna ma wanassa bess ».
Mais ces carrefours ont changé de forme. Ils ont quitté les angles poussiéreux des quartiers populaires pour se fondre dans les lumières bleutées des écrans de téléphone. Aujourd’hui, les jeunes Tchadiens ne s’installent plus devant les devantures pour refaire le monde. Ils s’installent dans les lives TikTok. Ils ne boivent plus du thé en commentant l’actualité du coin, ils scrollent frénétiquement pour ne rien rater des derniers clashs, des confessions amoureuses, des humiliations publiques, des histoires de cœurs brisés, de fiertés blessées et de fortunes soudaines.
TikTok est devenu notre nouveau carrefour
Un carrefour hyperconnecté, sans limites, sans modérateur, sans contexte. Un carrefour où tout le monde parle, où personne n’écoute, où l’on juge en rafale et où l’on commente à coups de likes et de moqueries. Un carrefour où l’on ne tue plus le temps, on se perd dedans.
Car ce qui faisait la beauté de nos anciens carrefours, c’était aussi leur légèreté. On exagérait, oui, mais on savait que c’était pour rire. On montait des histoires en épingle, mais c’était un jeu. Une tradition orale, un théâtre de quartier, un espace de respiration.
Aujourd’hui, cette culture de l’exagération a muté, et le virus du buzz l’a infectée. L’exagération n’est plus une soupape : elle est devenue stratégie. Elle n’est plus ancrée dans le réel : elle est performée pour exister dans l’algorithme. On ment, on surjoue, on s’invente des vies, on provoque, on clash, non plus pour passer le temps, mais pour exister, pour engranger des vues, pour gratter des abonnés, pour vendre une image.
Et ce n’est pas anodin. Car une société qui ne prend plus le temps de wanassa bess, de rire pour oublier, de parler pour s’écouter, devient une société où la parole n’a plus de poids. Où la vérité se dissout dans la mise en scène permanente. Où chacun devient son propre micro-drama ambulant.
Le carrefour, autrefois lieu de vie, de contradiction et de communion populaire, est devenu une scène numérique où l’on s’applaudit soi-même en espérant être vu. Il ne s’agit pas de rejeter TikTok, ni de diaboliser les nouvelles formes d’expression. Il s’agit de se demander : que sommes-nous en train d’y perdre ? Ce qui faisait le ciment de notre manière de parler, d’analyser, de raconter, de débattre, c’était aussi une sagesse populaire, une façon de relativiser le drame. Or aujourd’hui, le drame est devenu le produit.
Peut-être que l’esprit du vieux carrefour n’est pas mort. Peut-être dort-il quelque part, en attente d’un nouvel équilibre. Mais en attendant, on ferait bien de se demander si les lives TikTok, eux, nous rassemblent vraiment ou s’ils nous dispersent davantage.