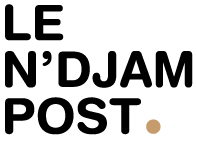Plusieurs hommes affirment avoir vu leur sexe rétrécir ou disparaître temporairement. Si la médecine ne reconnaît pas ces cas, le phénomène sème la panique dans la capitale.
À N’Djamena, le climat est tendu. Depuis plusieurs jours, des hommes témoignent en public avoir « perdu » leur sexe ou l’avoir vu « se rétrécir » après un contact suspect. Dans les marchés, les quartiers ou les places publiques, les scènes se multiplient : des individus crient à l’aide, montrent leur détresse, souvent entourés par une foule inquiète.
Pour certains, le sexe « revient » après quelques minutes. D’autres disent être allés voir des pasteurs pour obtenir une prière ou une bénédiction. « Mon sexe a diminué d’un coup. J’ai eu peur. Les gens autour ont crié. Après un moment, c’est revenu », confie un jeune homme croisé dans le 9ᵉ arrondissement.
Dans cette atmosphère de suspicion, certains individus ont déjà été accusés à tort sur la base d’un simple geste ou d’un contact accidentel. Dans un contexte marqué par la défiance envers les autorités et les frustrations sociales, ces cas prennent rapidement de l’ampleur. Des accusations non fondées peuvent rapidement dégénérer en violences physiques, comme l’ont montré des cas de lynchage ou de fouilles publiques humiliantes.
La réponse des autorités
Face à cette vague de témoignages, le gouvernement a tenu une conférence de presse ce 17 avril 2025. Gassim Chérif, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, accompagné d’Ali Ahmat Aghabache, ministre de la Sécurité publique, a tenté de calmer les esprits. « Il n’existe pas de vol de parties génitales. Aucune démarche médicale ne le prouve », a affirmé le ministre de la Communication. « Ces fausses informations doivent cesser », a renchéri son collègue en charge de la Sécurité publique.
Les professionnels de santé interrogés parlent d’un trouble psychologique collectif. Certains évoquent un syndrome connu sous le nom de « Koro », observé notamment en Asie, dans lequel un individu est persuadé que son sexe se rétrécit ou disparaît. Dans une société où les explications mystiques trouvent encore un écho fort, ces événements sont rapidement interprétés comme des actes de sorcellerie ou d’attaques spirituelles.
En tant que journaliste, il est difficile de couvrir un sujet aussi sensible. Faut-il ignorer ce que les gens disent vivre ? Faut-il tout attribuer à la folie collective ? Ni l’un ni l’autre. Il faut documenter, interroger, recouper les récits et toujours chercher la vérité avec éthique.
La situation actuelle appelle à une grande responsabilité citoyenne. Accuser quelqu’un sans preuve, le violenter ou se laisser emporter par la panique peut avoir des conséquences graves. Le rôle des médias, aujourd’hui plus que jamais, est aussi d’apaiser : informer sans enflammer.