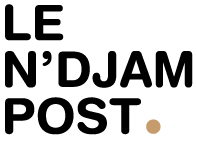C’est une polémique qui agite le pays depuis plusieurs jours. Au Tchad, la question de l’attribution du domicile conjugal après un divorce fait couler beaucoup d’encre et enflamme les débats, sur les réseaux sociaux. L’idée selon laquelle un homme pourrait être légalement tenu de laisser la maison à son ex-épouse, en particulier lorsqu’elle a la garde des enfants, divise profondément la société tchadienne. Mais au-delà de l’émotion et des arguments passionnés, il s’agit surtout d’une question de protection des plus vulnérables et de justice sociale.
Car le Tchad n’est pas un cas isolé. D’autres pays, y compris à majorité musulmane comme le Maroc et la Tunisie, ont mis en place des dispositifs similaires, sans que cela provoque les mêmes crispations. Dans ces États, il ne s’agit pas de spolier un ancien conjoint de ses biens, mais de garantir à l’épouse divorcée et aux enfants un cadre de vie stable après la séparation.
Dans de nombreuses législations, le droit au logement après le divorce est pensé d’abord en fonction de l’intérêt des enfants. Forcer une mère ayant la garde des enfants à quitter le domicile conjugal faute de solution de relogement est souvent dramatique pour les familles les plus précaires. C’est ce principe qui fonde, dans plusieurs pays, l’attribution provisoire ou durable de la maison à la personne en charge des enfants.
Au Maroc, la loi prévoit que l’époux doit fournir un logement décent à ses enfants après le divorce, ce qui peut impliquer de laisser l’usage de la maison familiale à la mère si celle-ci en assure la garde. En Tunisie, les juges statuent au cas par cas sur la répartition des biens, mais la priorité est donnée au maintien des enfants dans leur environnement habituel.
Le débat au Tchad est souvent ramené à une opposition entre normes religieuses et modernité. Pourtant, dans des sociétés aussi diverses que celles du Canada, de l’Espagne ou encore de la Jordanie, des règles existent pour protéger le conjoint économiquement plus faible, généralement la femme, après un divorce. Ces règles peuvent inclure le maintien dans le logement familial, le temps qu’une solution soit trouvée, voire plus durablement lorsque des enfants sont concernés.
Il en va ainsi de la justice sociale : dans de nombreux cas, la femme divorcée se retrouve dans une position d’infériorité économique, soit parce qu’elle s’est consacrée aux enfants au détriment de sa carrière, soit parce qu’elle a moins de ressources financières. La loi intervient alors pour rétablir un équilibre, sans pour autant priver le père de ses droits.
Le regard des religions : convergences et nuances
Il serait simpliste de réduire cette question à un débat religieux. Si, au Tchad, l’islam est la religion majoritaire, d’autres confessions sont bien présentes, et l’enjeu dépasse le cadre de la foi. Cela dit, il est important de rappeler que le droit musulman, dans certaines interprétations, prévoit que l’homme doit garantir un toit à la mère de ses enfants après la séparation, tant qu’elle en a la garde. En Égypte, en Jordanie ou dans les Émirats arabes unis, des textes de loi, souvent inspirés de la charia, imposent un logement à la femme divorcée durant une période transitoire, voire plus longtemps dans l’intérêt des enfants.
Les traditions chrétiennes, elles aussi, dans leur diversité, prônent la protection des plus faibles après la dissolution d’un mariage. Et même dans les systèmes juridiques laïcs, comme en France ou en Allemagne, le législateur impose parfois à l’un des conjoints, souvent le père, de garantir un logement au parent gardien, pour assurer la continuité de la vie familiale des enfants.
Un débat tchadien, des solutions tchadiennes ?
Au Tchad, ce débat est d’autant plus sensible qu’il touche à la propriété, question centrale dans une société où la terre et le logement sont des marqueurs sociaux essentiels. Pour beaucoup, « laisser la maison à l’ex-femme » est perçu comme une humiliation ou une perte de statut.
Pourtant, face aux réalités sociales — taux de chômage élevé chez les femmes, accès difficile à la propriété, pauvreté accrue après le divorce —, certains estiment qu’une réforme est nécessaire. « Le législateur tchadien pourrait s’inspirer de ce qui se fait ailleurs, tout en respectant nos spécificités », suggère un juriste tchadien. « Ce n’est pas une question d’imposer un modèle occidental ou musulman, mais de penser une solution juste pour nos familles. »
Le débat sur le droit au logement post-divorce cristallise des tensions profondes : entre hommes et femmes, entre modernistes et conservateurs, entre religieux et laïcs. Mais il interroge aussi la manière dont la société tchadienne envisage l’équité dans les rapports hommes-femmes.
Au fond, la question n’est pas tant de savoir qui possède la maison, mais de garantir à chacun des membres de la famille, en particulier aux enfants, un avenir plus serein après l’échec d’une union.