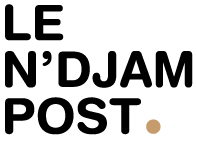C’est une première dans l’histoire politique du Tchad. Le 26 février, les conseils provinciaux élus lors des élections couplées du 29 décembre 2024 seront officiellement installés. Un tournant dans la gouvernance locale, qui donne naissance à des assemblées censées représenter les intérêts des provinces et équilibrer le pouvoir des gouverneurs. Mais derrière la réforme, une question demeure : ces nouveaux conseils vont-ils réellement changer la donne pour les citoyens ?
Un nouvel acteur dans la gestion des provinces
Jusqu’ici, l’administration provinciale était une affaire strictement gérée par l’État central. Les gouverneurs, nommés par décret, disposaient d’une autorité quasi exclusive sur leur territoire. Avec l’arrivée des conseils provinciaux, le schéma évolue : chaque province sera désormais dotée d’un organe délibérant élu.
Ces conseils, composés de représentants issus des différents départements, auront pour mission de voter les budgets provinciaux, débattre des priorités locales et suivre la mise en œuvre des projets de développement. En clair, ils deviennent un contrepoids aux gouverneurs, et une interface directe entre l’administration et les citoyens.
Officiellement, cette réforme vise à rapprocher les décisions des réalités du terrain. Fini, en théorie, les choix imposés depuis N’Djamena sans concertation avec les habitants. Désormais, chaque province devra fonctionner avec un budget discuté et adopté localement, et des projets censés correspondre aux attentes des populations.
Une réforme qui pourrait tout changer… ou presque
Sur le papier, cette avancée renforce la démocratie locale. Dans les faits, la réussite de cette réforme dépendra de la capacité des conseils à s’imposer face aux gouverneurs et à faire entendre la voix des citoyens.
Le principal enjeu sera la transparence. Désormais, les élus provinciaux auront un droit de regard sur la gestion des ressources locales. L’argent alloué aux provinces ne sera plus uniquement administré par l’exécutif, mais aussi soumis à l’examen d’une assemblée élue. Un garde-fou qui pourrait limiter les détournements et rendre l’action publique plus efficace.
Mais pour que cela fonctionne, il faudra que ces conseils aient les moyens de leur action. Leur budget, leurs prérogatives et leur indépendance vis-à-vis des autorités centrales seront des éléments déterminants. Un conseil provincial sans ressources ni pouvoir de contrainte ne serait qu’un organe consultatif de plus, sans véritable impact sur la vie des citoyens.
Un test pour la décentralisation
L’installation des conseils provinciaux est une étape clé dans la mise en place d’une gouvernance locale plus autonome. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large qui vise à réorganiser l’équilibre des pouvoirs entre l’État et les collectivités territoriales.
Dans un pays où la centralisation a longtemps été la norme, cette réforme est un test grandeur nature : l’État acceptera-t-il de céder une partie de son contrôle ? Les élus locaux auront-ils les moyens de s’imposer ?
Pour les citoyens, le changement sera palpable si ces conseils jouent réellement leur rôle. S’ils réussissent à imposer des budgets plus justes, à accélérer la réalisation des infrastructures locales et à améliorer la gestion des services publics, alors leur existence sera pleinement justifiée. Mais si leur marge de manœuvre reste limitée, ils risquent d’être perçus comme une façade démocratique sans impact réel.
Quoi qu’il en soit, le 26 février marquera le début d’une nouvelle ère administrative au Tchad. Reste à voir si ces conseils provinciaux seront les moteurs du changement… ou les témoins d’une réforme inachevée.