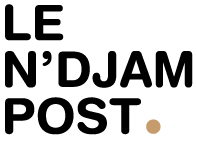Le Tchad a récemment été le théâtre d’affrontements intercommunautaires sanglants qui ont endeuillé de nombreuses familles et la nation tout entière. Cette séquence de confrontations meurtrières s’est déroulée dans le canton de Mandakao, avec comme objet de litige et point de départ de cette déflagration un différend foncier. Le bilan officiel déplore une quarantaine de morts et de nombreux blessés. Ce drame aurait pu laisser indifférent s’il y avait lieu de le ranger dans le registre des tensions qui pourraient surgir dans des espaces vitaux au sein desquels l’accès aux ressources est considérablement réduit et rend par conséquent inéluctable des affrontements entre des groupes communautaires.
Or, les drames qui viennent de susciter l’indignation et la stupeur au sein de la communauté nationale nous interpelle à plus d’un titre parce qu’ils viennent s’ajouter à des précédents tragiques. Ils viennent nous rappeler que l’entreprise de construction nationale demeure au Tchad, non seulement un chantier permanent, mais aussi prioritaire.
Le dialogue national inclusif et souverain (DNIS) de 2022 a eu la perspicacité de faire un diagnostic sans complaisance et sans précédent des maux qui mettent à péril au Tchad l’indispensable vivre ensemble, et menacent à court terme la cohésion nationale. Dans la recommandation 14 de ses résolutions, les participants affirment la nécessité de « Créer et renforcer les mécanismes de prévention et de gestion des conflits intercommunautaires ».
Cette exhortation qui apparaît aujourd’hui d’une brûlante actualité vient à point nommé nous rappeler qu’au Tchad, comme dans de nombreux Etats africains, les citoyens ne font pas encore nation, tout au moins la nation telle que les discours ressassent ce concept demeure dans les limbes. Preuve est faite qu’au regard des événements tragiques de Mandakao et des nombreux autres qui les précèdent depuis des décennies, le vivre ensemble effectif demeure au Tchad une quête de tous les instants.
Pis encore, il y a même lieu de conclure à une régression du vivre ensemble au Tchad, car, la Constitution de 2023, dans son préambule, rappelle que le Tchad est « Fier de sa diversité culturelle et de son histoire, le Tchad était une terre des empires, des royaumes et des chefferies traditionnelles, qui ont fédéré les populations diverses qui y vivent ».
C’est dire que les Tchadiens n’ont pas su perpétuer au fil des ans le précieux héritage précolonial profondément enraciné dans nos cultures, afin de conjurer les démons des particularismes ethniques qui pourraient embraser notre pays à tout moment aujourd’hui.
Réconcilier les cœurs pour sauver l’unité nationale
Si les emblèmes de l’Etat, les slogans patriotiques et les textes de lois sont des ferments de l’unité nationale, ils ne remplaceront jamais la paix et la concorde véritables qui viennent des cœurs, des valeurs humaines partagées au quotidien et donnent leur signification véritable au vivre ensemble. La récurrence des conflits intercommunautaire devient si préoccupante qu’il est temps pour les plus hautes autorités d’en faire une cause nationale.
Dans un rapport d’août 2024, moins d’une année avant la tragédie du vivre ensemble à Mandakao, l’ONG International Crisis Group tirait sur la sonnette d’alarme dans un rapport intitulé : Tchad : rompre avec le cycle des violences pastorales.ICG déplore que « Le nombre de conflits agropastoraux atteint un niveau sans précédent dans le sud et le centre du Tchad pendant la période de transition politique (2021-2024). Ces violences qui ont fait plus d’un millier de morts et plus de 2000 blessés, renforcent la perception d’un clivage entre le nord et le sud. (…) Le président Mahamat Deby Itno devrait faire de la résolution des conflits agropastoraux l’une des priorités de son mandat. Son gouvernement devrait apporter à cette question une réponse sécuritaire et judiciaire impartiale, et impliquer les populations affectées dans les efforts de médiation afin de rétablir leur confiance envers l’Etat ».
Que ce soit un acteur extérieur au Tchad qui s’en inquiète si vivement, est un indice suffisamment préoccupant afin que les autorités du Tchad prennent enfin le taureau par les cornes.
L’absence de mesures étatiques vigoureuses, implémentées scrupuleusement sur la longue durée, pourrait à très court terme faire le lit de drames plus graves, au risque de voir l’irréparable se produire à plus grande échelle. L’histoire tragique de certains pays africains non loin du Tchad doit interpeller plus que jamais les garants du bon fonctionnement de l’Etat et de la cohésion nationale. Ce cycle infernal doit d’autant plus être arrêté qu’il est devenu politique et fait peser des risques de partition du pays, parce que certains croient y voir un conflit entre les deux principaux blocs régionaux du pays. Cette perception est pourtant factice, mais à l’heure des réseaux sociaux et des autoroutes de l’information, de telles approches biaisées de la réalité anthropologique de notre pays gagnent rapidement en crédibilité.
En somme, il est grand temps que l’Etat du Tchad prenne à bras le corps le péril que font peser les conflits intercommunautaires sur la consolidation du vivre ensemble au Tchad.
Eric Topona Mocnga, journaliste à la Deutsche Welle