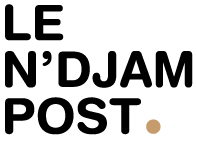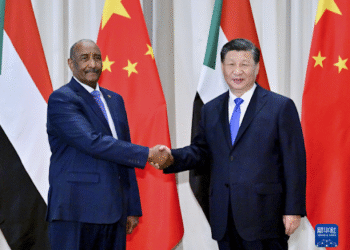C’est dans la liesse et des manifestations de rue, le mardi 28 janvier 2025, que des foules ont célébré par milliers la sortie officielle du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Au Mali, l’ambiance était nettement moins festive que dans les deux autres Etats de la nouvelle confédération dénommée Alliance des États du Sahel (AES).
Si son acte constitutif a été officialisé le 16 juillet 2024, la date du 29 janvier 2025 constitue la consécration officielle d’une rupture historique pour ces trois États et une frange de leurs populations. Du côté de la Cedeao, il a été laissé à ces trois États six mois supplémentaires pour réintégrer « sans conséquences » ce qui fut jusqu’à cette date leur grande famille géopolitique ouest-africaine. La porte demeure ouverte comme en témoignent les efforts incessants de la diplomatie togolaise pour reconstituer l’ensemble Cedeao, ou l’initiative récente du nouveau chef de l’Etat ghanéen, John Dramani Mahama qui a nnommé un émissaire chargé de négocier avec l’Alliance des Etats du Sahel : Larry Gbevlo-Lartey, ancien haut gradé de l’armée ghanéenne et qui fut également chargé de la lutte anti-terroriste au sein de l’Union africaine.
Si la date symbolique du 29 janvier 2025 a donné lieu à moult analyses et commentaires, c’est en partie parce que jusqu’à cette date butoir, ils étaient nombreux qui espéraient voir les trois initiateurs de ce schisme revenir sur leur décision de rupture.
Rupture définitive ?
Toutefois, peut-on conclure rétrospectivement à une rupture véritable avec la Cedeao et à la constitution effective d’un nouveau bloc géopolitique distinct et autonome ?
Si les griefs de ces trois Etats à l’endroit de la Cedeao ne manquent pas de pertinence en certains points, leur volonté effective de créer une alliance distincte et souveraine des Etats et des Peuples n’est pas moins questionnable. La nouvelle AES n’est pas née d’un projet idéologique profondément pensé et construit, mais d’une conjoncture politique commune à ces trois Etats du Sahel, à savoir leur refus de se soumettre aux sanctions de la Cedeao qui leur enjoignait un retour à l’ordre constitutionnel, tout en les soumettant à un régime de restrictions sévères qui s’est avéré à la longue contre-productif, dont l’une des conséquences a été de légitimer dans l’esprit des populations le discours souverainiste de ces régimes militaires.
Mais dans le même temps, depuis l’acte constitutif du 16 juillet 2024, l’Alliance des Etats du Sahel, initialement portée sur les fonts baptismaux pour sécuriser leurs territoires respectifs et lutter contre la nébuleuse terroriste à laquelle ils sont tous confrontés et dans des proportions véritablement dramatiques, a multiplié des initiatives bien au-delà d’une mutualisation des forces de défense et de sécurité qui jusqu’à présent ne sont pas allés au-delà des effets d’annonce : la création d’une banque et d’une monnaie commune, la création d’un passeport commun, et plus récemment la création d’une force commune de 5000 hommes pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur leurs territoires respectifs.
Force est cependant de constater que de la parole aux actes, seul le seuil de la parole a été franchi. Même le passeport communautaire de l’AES n’est pas encore effectif, même si le chef de la junte du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré s’est fait enrôler en milieu de semaine et a reçu son passeport biométrique.
La force commune est en réalité en grande partie effective. Elle s’est déployée au Burkina Faso lorsque le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré a vacillé à la suite de bruits de bottes que certains observateurs considèrent comme une révolution de palais. En revanche, cette entraide militaire n’a pas été effective lorsque Bamako a été victime d’une attaque de grande ampleur et à plusieurs points névralgiques de la capitale malienne. Quant aux résultats de la lutte contre le terrorisme, ils demeurent mitigés.
Identité diplomatique
Sur le plan diplomatique, nul ne peut dire à ce jour quelle est l’identité diplomatique de l’Alliance des Etats du Sahel. Comment se positionne-t-elle par rapport aux grands enjeux du monde actuel et plus proche de celle-ci, quelles relations entend-elle entretenir avec la Cedeao? Au-delà de ses positions sur la circulation des personnes, tout reste à bâtir quant aux relations futures entre l’AES et la Cedeao.
Dans le même temps, il est très important de souligner que les Etats de l’AES demeurent membres de de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Elle continue de partager avec de nombreux Etats de la Cedeao des convergences économiques et monétaires, se soumettant avec ceux-ci à des principes de régulation communs.
Au regard de cet état des lieux de ce nouveau projet communautaire, peut-on parler d’un « retrait effectif » de la Cedeao de ces trois États de l’AES ? Des raisons objectives penchent plutôt pour le doute, voire le scepticisme. L’interdépendance prononcée qui caractérise le champ des relations internationales actuel est tel qu’un acte de rupture ou la volonté de faire cavalier seul, ne se décident pas sur un coup de sang, y compris lorsqu’il s’agit des nations parmi les plus anciennes ou des Etats les plus avancés. Huit ans plus tard, après le Brexit qui était censé rendre au Royaume-Uni sa grandeur, ce divorce a coûté à ce pays 170 milliards d’euros. En raison des restrictions à la circulation des personnes, les fermiers britanniques n’ont plus recours à la main-d’œuvre des saisonniers des pays de l’Est lorsque arrive le temps des récoltes. Un dramatique retour à la réalité qui fait dire à un fermier britannique qui regrette son vote en faveur du Brexit : « C’est mon cœur qui l’a emporté sur ma tête ».
Éric Topona Mocnga, journaliste à la Deutsche Welle